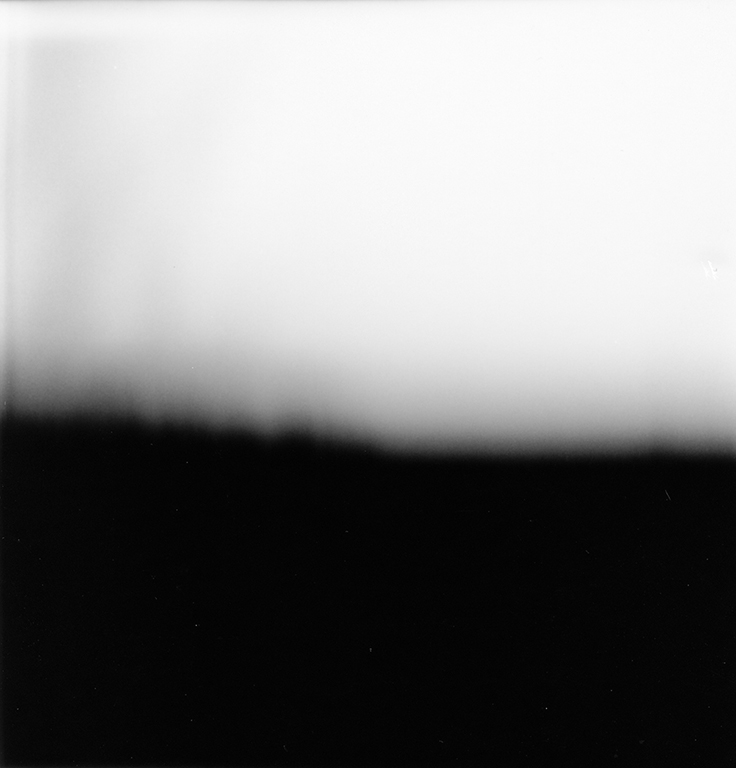





Le Covid-19 n’aura pas seulement débouché sur du négatif. Des fonds soulevés par le Département pour amener un peu d’air, par l’intermédiaire d’artistes, aux institutions plombées nous ont permis d’élaborer un projet avec un photographe. Mais avant cela, il y a une histoire qui a déjà débuté depuis plusieurs années. Reprenons-là à sa source…
Cela fait un moment que Sophie Stavroulakis, enseignante de l’Éducation nationale, et moi, Léa Talabard, psychologue, travaillons ensemble à Casado, maison des adolescents de Saint-Denis. Nous avons en premier lieu pensé « à notre manière » et avec notre désir, un groupe, pour finalement peu à peu tenter de nous approcher au plus près de ce que pouvaient demander les adolescents ou du moins les adolescents en souffrance qui se présentaient dans notre institution. Ainsi d’un groupe avec une médiation figée, le conte, les histoires, nous nous sommes décalées, choisissant de partager un moment important avec eux : le réveil – ce groupe est l’unique qui débute à 9h30 à Casado. Suit ainsi, après un petit déjeuner – partagé ou non – aux grès des envies, des disponibilités ou possibilités de chacun, une proposition à faire une activité ensemble. Faire… Parfois nous passons ainsi des séances et des séances à « faire » ensemble avant que n’advienne quelque émergence du sujet propre. « Allez on se réveille » : nom très pragmatique pour montrer que l’atelier a lieu le matin, pour dire qu’un temps est nécessaire pour y être. Atelier pensé pour accueillir les décrocheurs, les déscolarisés, les agités, les déprimés, donc généralement ceux qui ne se lèvent pas, dorment mal et ont un rapport compliqué à l’école. « Allez on se réveille » car souvent ces adolescents se sont endormis dans cette posture ; ils ne font plus grand chose, ne sont affectés par rien, et surtout : ils ne veulent rien. Besoin d’un temps de pause pour se réveiller, et vouloir pour soi-même. Ainsi nous ne faisons que proposer, susciter, essayer, échouer et recommencer. Nous passons des jeux de société à la relaxation, de la cuisine aux collages, des travaux d’écriture aux discussions… Et c’est là où nous sentons qu’un petit quelque chose a bougé : quand ils commencent à parler. À parler vraiment. Les mots – maux -, matière palpable, consistante, légère comme engluée, imprécise, trompeuse.
À les écouter nous ne partageons pas le même monde, cela c’est malheureusement d’une triste banalité, mais ils ne se comprennent pas forcément entre eux. « Toi du dis ça ? ». Nous découvrons en épluchant quelques mots que ce n’est plus seulement une question de classe sociale, ou d’origine culturelle mais aussi de villes, de quartiers, peut-être même d’individu. À chaque séance, les jeunes nous assomment de nouveaux signifiants. Nouveaux le sont-ils vraiment ? Entre les mots qui changent de sens, ceux qui sont mis au placard « Ah non Madame vous pouvez pas dire ça, ça fait trop bizarre », ceux qui empruntent aux langues étrangères et ceux qui pourraient appartenir au registre de lalangue…
Nous sommes quelque peu perdues.
Ainsi, nous avons commencé à réfléchir à ce monde tout particulier qu’ils nous offraient en recueillant des mots, en leur donnant du sens, en soulevant des malentendus, en approfondissant des notions, en cherchant des nuances. L’idée nous est venue de créer un dictionnaire de leurs mots influencés par les nôtres peut-être. Des mots noirs, il y est question de cauchemars, d’expulsion, d’exclusion, de bagarres, de violence, mais aussi de filles, d’amour, de liberté, de famille, d’horizons.
L’idée d’inscrire, presque de « capturer » à un temps donné ces mots en mouvements si particuliers et intimes, ces mots colorés et multi-sens nous a semblé alors essentiel.
Les regrouper en premier lieu, puis les disséquer, les partager, leur donner une place enfin dans un objet commun. Cet objet, ce dictionnaire – éphémère car il suffit d’un jeune qui s’absente pour que le sens soit autre – nous a semblé fondamental pour laisser une trace, pour donner la parole à ce moment si particulier de la vie qu’est l’adolescence, et peut-être même l’adolescence pendant le Covid-19. Nous avons eu envie de donner chair, de pouvoir concrètement porter ensemble cet abécédaire remplis de mots, vivants, partagés.
Dans le groupe les jeunes viennent d’ici et d’ailleurs, sont collégiens et lycéens, ont des origines au Maghreb, en Afrique noire, ou encore à Madagascar. Le groupe est varié et variable : les jeunes viennent une fois sur deux, chaque fois, tout le temps, un mois, trois mois, s’arrêtent. Parfois un seul vient, parfois ils sont deux, trois, quatre parfois ils sont dix. Ils ont douze, quatorze, quinze, dix-sept, dix-huit ans, filles, garçons, exclus, déscolarisés, bavards, « abattus », bagarreurs, battus, impulsifs, ils ont des histoires, disent des ragots, ont des chagrins. Il y a du vide, du trop-plein, de la colère, de la tristesse, des émotions même s’il faut du temps pour s’en approcher.
Nous nous sommes aussi rappelées que l’image fait partie de leur monde. Alors, pour injecter du « Casado », nous avons souhaité que les jeunes se décalent. Plutôt que l’image virtuelle, nous avons proposé la photographie, la vraie. Avec un vrai photographe avec de vrais appareils, avec même la chambre photographique, véritable étoile du monde argentique. Avec la chambre, on doit se poser, faire tranquillement, prendre le temps. Nous ne voulions pas non plus une photo figée, posée. Comment alors saisir sans fixer, comment rendre vivant les jeunes en les faisant s’assoir, comment les prendre de façon authentique tout en respectant leur spontanéité. Un peu comme ces photos en noir et blanc, avec leur position souvent tranchée, leur « tout ou rien », leurs étiquettes à jamais collées sur leurs destins. Il s’agissait pour nous de leur montrer toutes les nuances possibles, et justement de leur faire entrevoir le gris qui pourrait leur ouvrir de nouveaux horizons.
C’est ainsi que Fausto Urru, artiste sarde, nous a rejoint un mardi de janvier. Fausto était chargé de vieux appareils photographiques et de sa manière bien particulière d’habiter le monde. Avec lui aussi il a fallu construire un discours, une histoire commune.
Les jeunes qui nous sont orientés sont, essentiellement, sans désir. Ils le manifestent en n’allant plus en cours, ou en s’agitant en classe, en constellant leurs présences d’absences, en disant « oui » comme ils pourraient dire « non ». Leur vide est palpable, leur tristesse, leur indifférence aussi. Chacun est replié sur soi.
Première séance de photographies : ça rate. Les blagues de Fausto sont étouffées par un silence glacial. Seulement quelques images apparaissent. Toutes les autres s’y refusent.
Deuxième séance, les jeunes nous expliquent qu’ils n’aiment pas se voir. D’ailleurs enlever le masque lors d’un portrait s’apparente à une mise à nu presque gênante. Et puis on découvre les visages… On ne reconnaît pas l’autre. « Ah t’es trop bizarre, je ne te reconnais pas » « Quoi ? – dit l’autre terrifiée – mais alors si je ne suis pas moi qui suis-je ? » Problème technique à nouveau, les portraits restent dans l’ombre…
Troisième jour. L’appareil a de nouveau un problème. Nous – les professionnels – sommes dépités. Nous nous trouvons dans une institution de soin et « ça » nous travaille… Comment expliquer aux jeunes qu’un photographe puisse avoir un appareil photographique dysfonctionnant. Que tout ce travail fourni ne donne rien ? Étrangement, aux nouvelles négatives que leur apporte le photographe, les jeunes ne mouftent pas. Certes, l’apathie gèle tout, la tristesse comme la joie mais… Il n’y a pas que cela. Une porte s’est ouverte. Et s’il était des leurs ?
Ainsi, au fil des séances « ratées » – qui peu à peu le deviennent de moins en moins -, nous voyons les jeunes se découvrir. Au sens figuré comme propre. Ainsi E. devient de plus en plus coquette, S. peut nous faire part de ses inquiétudes envers la cité, V. trouve sa place, oscillant entre la grande sœur bienveillante avec les plus jeunes ou la bonne amie créant les liens entre les plus grands… Les jeunes prennent la parole, nous accueillons ces bourgeons d’intime avec attention.
Alors on tente de tricoter ensemble, d’entremêler nos mondes, les mots et les images, de construire une trace commune de ce passage à Casado.
Laisser une trace, pas si simple surtout au moment de l’adolescence. Oui je veux faire de la photo mais non je ne veux pas qu’on me prenne, oui je veux qu’on me prenne mais non je ne veux pas donner mon autorisation pour la publication, aller/retours, ambivalence, toute puissance, régression et puis ça sert à quoi, qui va regarder cet objet ? Avec qui allons-nous le partager ?
Nous nous laissons embarqués par le courant. C’est vrai, qui va s’intéresser à eux, à nous ?
Les jeunes disparaissent, reviennent, signent une autorisation, font un pas de côté. L’énergie revient, le collectif est là. Mais le chemin n’est pas simple.
Quoi prendre en image pour se représenter si on ne s’aime pas soi ? Alors nous passons de parties d’eux morcelées – mains, genoux, cheveux, chemise – aux façades de maison, aux ombres fluctuantes, à la petite pousse qui sort du bitume pour revenir un peu plus tard vers eux. Depuis peu, l’artiste arrive à les capter. Avec sa chambre photographique, immense appareil photo qui en impose, il les amadoue de longues minutes durant. Être soi sans séduire, sans rire, sans gêne.
Nous prenons le temps de se chercher, de se trouver. Nous scindons les espaces. Ma collègue et moi d’un côté, l’artiste de l’autre avec son modèle. Chacun passe d’un espace à l’autre, à son rythme, sans pression puisque l’expérience faisant on se rend bien compte que rater est possible, que cela attaque mais ne tue pas.
Tenter de les comprendre, de les entendre, d’être au plus prés. Parfois de l’énergie, de la joie, des rires, de l’isolement, des bêtises. Qu’est-ce qu’ils nous disent, qu’est-ce qu’ils nous montrent, qu’est- ce qu’ils nous glissent, que viennent-ils chercher, que viennent-ils prendre ? De quoi parle-t-on, que montre-t-on de nous ?
La complexité, l’ambivalence, on se rate, on chuchote, on s’expose, on se retire. On provoque, on a peur, on se tait, et puis on revient. Car c’est ce qui fait la rencontre, l‘aventure humaine, à chaque pas on craint l’effondrement mais si le cadre est là, nous survivons. Ensemble.
Léa Talabard & Sophie Stavroulakis
Ce projet a reçu le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du Plan de rebond écologique et solidaire. Merci au Dr Jean-Pierre Benoit, Chef de service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Delafontaine, de nous avoir laissé la liberté de réaliser ce projet et à l’équipe de Casado, présente, inditionnellement.
